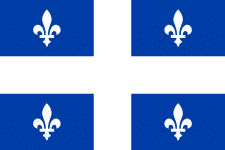Au Québec (Canada), un collectif de parents a exprimé son inquiétude dans la presse sur la façon dont est abordée la dysphonie de genre chez les enfants (lire ici).
Entretien avec deux des signataires, Clémence Trilling, Nadia El-Mabrouk, membres fondateurs de « pour les droits des enfants du Québec ».
Entretien original sur le site de l’observatoire La petite sirène.
Vous faites partie des parents qui ont exprimé votre inquiétude à la suite d’une communication des pédiatres canadiens au sujet de la transition de genre des enfants. Pourquoi ?
Nous nous inquiétons depuis déjà quelques années de la place importante que prend l’idéologie du genre dans les institutions publiques au Québec et au Canada, y compris dans nos écoles primaires et secondaires, notamment à travers le programme d’éducation à la sexualité. Il faut savoir que nous sommes un collectif de parents dont les enfants sont inscrits dans des écoles du système scolaire public québécois.
Récemment, nous avons découvert la page web sur l’identité de genre de la Société canadienne de pédiatrie (un document d’ailleurs largement diffusé sur des sites éducatifs très consultés). Nous avons été stupéfaits de constater le manque de rigueur scientifique et la teneur idéologique de ce document qui se contente, en fait, de relayer la rhétorique et le jargon des idéologues du genre. On y retrouve les mêmes termes et définitions qu’il faut désormais accepter sans questionnement: « identité de genre », « expression de genre », « sexe assigné à la naissance ». L’«identité de genre » désigne le sentiment intime et profond qu’une personne a d’elle-même et qui fait que l’on se sent homme, femme ou « autre ». Cette notion à forte dimension politique et idéologique, popularisée par les sciences humaines, entérine une conception de l’humain où le ressenti a préséance sur la réalité matérielle : dirait presque un discours religieux où l’on nous instruit sur l’âme.
Les familles sont encouragées à « n’écarter aucune possibilité pour leur enfant » puisque « l’identité de genre » peut changer en tout temps. Peu importe le stade de développement de l’enfant, le fait qu’un garçon s’identifie comme étant une fille (ou inversement) ne fera l’objet d’aucunes hypothèses, d’aucunes autres explications ou investigations complémentaires: c’est comme ça!
Pourtant, dans une toute récente étude, un pourcentage important de « détransitionneurs » (personnes qui s’identifient comme détranstionneurs et qui cessent un processus de transition médicale ou souhaitent « l’inverser »), témoignent que leur dysphorie de genre était reliée à des conditions sous-jacentes.
Nous avons donc écrit, le 8 mars 2021, à la société canadienne de pédiatrie qui a tout de suite corrigé les terminologies inexactes que nous pointions dans notre lettre. Le sexe « assigné à la naissance » est devenu le sexe « constaté à la naissance ». Quand on sait que cette expression est à la base de tous les détournements de sens de l’idéologie de l’identité de genre, c’était déjà une victoire !
Malheureusement, il ne fallait pas se réjouir trop vite de ce sursaut d’objectivité car, en date du 16 avril 2021, la société canadienne de pédiatrie indique de nouveau que le sexe est « assigné » ! Nous nageons en plein scénario orwellien indigne de cette institution.
En effet, dans le dictionnaire, le mot « assigner » est synonyme des mots « attribuer », « destiner » ou « donner » quelque chose à quelqu’un. Autrement dit, ce terme sous-entend une prise de décision. Si le sexe est « assigné » par le médecin, cette décision engage-t-elle la responsabilité professionnelle du médecin ? Nous ne pouvons croire qu’un médecin considère qu’il assigne un sexe au bébé, pas plus qu’il ne lui assigne un poids, une taille ou un score APGAR. Il s’agit, dans tous les cas, de constater un certain nombre de faits sur une base objective. En fait, ce détournement de sens ouvre la voie à toutes sortes d’interprétations farfelues, notamment que le sexe peut être « réassigné ».
Nous avons écrit le jour même à la société canadienne de pédiatrie et nous leur avons proposé une rencontre de vive voix, ce qu’ils ont poliment refusé.
Au-delà des hésitations terminologiques, pourquoi un tel glissement idéologique lorsque les informations concernent le développement de la sexualité et l’image corporelle? Quel sera l’impact sur la confiance de la population envers l’ensemble des informations présentées sur la page de la Société Canadienne de Pédiatrie?
Ce qui nous préoccupe également en tant que féministes c’est que cette idéologie renforce paradoxalement les stéréotypes de genre en accordant une importance démesurée et régressive à « l’expression de genre » : habillement, maquillage, coiffure. Cette mouvance efface des décennies de luttes contre les idées préconçues.
Nous estimons qu’il est préférable d’encourager les jeunes à développer leur personnalité propre selon leurs compétences et leurs envies, quel que soit leur sexe, sans les enfermer dans des « identités ». Ne faudrait-il pas les aider à s’accepter comme ils sont, et notamment à aimer leurs corps et à en prendre soin, plutôt que de les amener à croire qu’ils pourraient être nés dans le mauvais corps?
Les parents qui pensent que le processus de transition demandé par leur enfant ne lui convient pas peuvent-ils s’opposer ?
C’est une excellente question. Il y a actuellement un père qui est en prison en Colombie-Britannique parce qu’il a parlé publiquement de son histoire malgré une injonction de la cour. Ce père refuse de considérer sa fille comme son fils, d’utiliser le nom et les pronoms choisis lorsqu’ils se parlent et s’est aussi opposé en vain à ce que sa fille suive un traitement à la testostérone.
Ici au Québec, malgré nos mises en garde, nos députés ont voté à l’unanimité le projet de loi 70 pour bannir les « thérapies de conversion ». Ce terme est traditionnellement utilisé pour désigner les pratiques qui visent à modifier l’orientation sexuelle d’une personne. Nous sommes bien d’accord que ces pratiques rétrogrades n’ont pas leur place dans une société ouverte à la diversité sexuelle. Mais, au Québec, aucun thérapeute sérieux ne pratique ce genre de thérapie depuis plusieurs années. Alors, pourquoi légiférer à ce sujet ? D’autant plus qu’il y a des ordres professionnels pour encadrer ses membres. Soit dit en passant, l’Ordre des psychologues du Québec avait déjà manifesté son objection à cette pratique en 2012. Le problème c’est l’amalgame qui est fait entre l’orientation sexuelle et l’« identité de genre »,.
En fait, le but presque avoué derrière ces projets de loi (PL-70 ou son homologue le C-6 en voie d’être adopté au niveau fédéral) est de faire passer toute thérapie de la dysphorie du genre qui ne soit pas une thérapie transaffirmative (qui, selon le stade de développement physique, peut s’accompagner d’une prescription de bloqueurs de puberté, d’hormones sexuelles, pour possiblement finir, à l’âge adulte, par des opérations chirurgicales d’ablation d’organes sains) pour une « thérapie de conversion » de l’identité de genre, et donc de l’interdire.
Nous n’avons pas encore constaté les impacts concrets de cette loi toute récente, mais nous sommes très inquiets.
Est-ce que l’autorité parentale d’un parent qui « n’affirme » pas immédiatement son enfant pourrait lui être retirée comme on l’a vu en Australie ? Est-ce que des psychologues et psychothérapeutes qui privilégient une méthode exploratoire neutre et prudente risquent des poursuites criminelles ?
Or, la dysphorie du genre, notamment chez les adolescents, est souvent accompagnée d’autres facteurs de comorbidité comme la dépression, l’anxiété ou l’autisme,. Il est important de bien comprendre la situation globale de l’enfant avant de l’orienter vers une médicalisation invasive, d’autant plus que, selon les études précédant la vogue de l’affirmation de genre, environ 80 %, des enfants qui disaient vouloir être de l’autre sexe se réconciliaient avec leur sexe de naissance à l’âge adulte.
Le professeur Kenneth Zucker,, une sommité mondiale en matière de dysphorie du genre, préconise de conduire une psychothérapie exploratoire, afin de tenter d’identifier avec le jeune les causes profondes et multiples de son mal-être. Malheureusement, sous la loi 70 (et C-6), il risque de ne plus rester aucun professionnel de la santé qui voudra offrir ce type de psychothérapie exploratoire puisque ces thérapies pourraient être assimilées à des thérapies de conversion, et, par conséquent, passibles de sanctions.
Au Québec, s’adresser à un enfant sans utiliser le prénom et le pronom revendiqué par lui pourrait-il tomber sous le coup de la loi ?
Il n’y a pas de jurisprudence en ce sens au Québec pour l’instant à notre connaissance. Le concept vague d’« identité de genre » est cependant inscrit comme caractéristique protégée dans notre charte des droits et libertés, ce qui permet déjà des revendications de la part des militants LGBTQ+ et des poursuites judiciaires assez innovantes.
Par exemple, en janvier 2021, une décision rendue par la Cour supérieure de Montréal à la suite de poursuite de personnes transgenre et non-binaires a décrété discriminatoires plusieurs articles du Code civil du Québec relatifs au certificat de naissance en raison de la présence des mots sexe, mère, père. Il ressort de cette décision que le « genre », et non le sexe, serait la véritable identité de la personne et que, par conséquent, ne pas désigner une personne par son genre souhaité serait discriminatoire. De là à poursuivre une personne pour « mégenrage », il n’y a qu’un pas.
En France, les transidentités chez les enfants commencent. Au vu de l’expérience acquise au Canada, quelle peut être selon vous une attitude ajustée de l’adulte en présence d’un garçon qui se dit fille et inversement ?
Du côté des parents, il faut tout d’abord écouter son enfant. Se montrer curieux de ce qu’il vit, de comment il se conçoit et conçoit le monde. Il est important de maintenir ou de (re)bâtir la communication et un lien de confiance avec lui. Il est non seulement possible, mais souhaitable, de valider ses sentiments sans pour autant valider le raisonnement qui l’amène à croire qu’il est transgenre. (Le groupe de support britannique Bayswater a rédigé à ce sujet un « top ten tips » qui vaut la peine d’être consulté.)
Du côté des écoles et du personnel scolaire, le mieux serait que le système scolaire se contente de remplir sa mission, soit d’enseigner des connaissances valides scientifiquement, sans prosélytisme idéologique. Le Royaume-Uni encadre mieuxles interventions « éducatives » faites par des groupes externes dans les écoles. Il est désormais interdit de laisser entendre aux enfants qu’ils sont « nés dans le mauvais corps » et d’inviter dans les écoles des groupes qui tiennent ce discours.
Au Québec et au Canada, cette prise de conscience et cette réflexion n’ont pas encore eu lieu. Au contraire, l’idéologie du genre est présente dans les programmes d’éducation à la sexualité, mise de l’avant par des enseignants ou par des groupes militants. Par exemple, dans une formation offerte par un syndicat d’enseignants québécois dont la vidéo est disponible, un militant en faveur de l’idéologie du genre intervient : « les mots « garçon », « fille », « monsieur », « madame », « mademoiselle » : c’est à éviter. Il recommande plutôt aux professeurs d’interpeller les élèves en disant « toi ».
Une mère ontarienne, Pamela Buffone, a d’ailleurs intenté une poursuite au Tribunal des droits de la personne, envers son école primaire qui a affirmé à sa fille de 6 ans : « there is no such things as boys and girls » (les filles et les garçons cela n’existe pas). Nous sommes en attente de la décision judiciaire.
La question de la transmission de connaissances fondées n’est pas la seule qui se pose. Concrètement, il faut réfléchir et trouver des solutions qui tiennent compte des besoins et des droits de tous et toutes, y compris le droit des jeunes filles à la sécurité et à la compétition équitable dans le sport féminin scolaire, par exemple. Pour l’instant, au Québec, le système scolaire doit s’adapter à l’identité de genre demandée par l’élève.
Du côté des thérapeutes, une attitude ajustée serait de prendre au sérieux le vécu des jeunes et de les accompagner par des psychothérapies exploratoires, dites « d’attente vigilante », qui ont fait leurs preuves, en leur offrant un espace thérapeutique permettant de répondre à leur mal-être, en utilisant les approches les moins invasives en premier lieu et non l’inverse.
Du côté de la communauté médicale, il serait à souhaiter qu’elle garde l’œil ouvert et adopte une attitude critique sur les débats scientifiques plutôt qu’être une thuriféraire de « l’affirmation de genre ». De nombreux pays européens (Suède, Finlande, Grande-Bretagne) font en quelque sorte « marche arrière » en matière de thérapie affirmative du genre, reconnaissant qu’il n’y avait pas assez de données probantes, de garde-fous et de balises dans le traitement des enfants dysphoriques.
Quel regard portez-vous sur les traitements médicaux que certains médecins prescrivent à l’enfant ?
« Avant tout ne pas nuire » comme le dit le serment d’Hippocrate.
Le public commence à comprendre que les bloqueurs de puberté ne sont pas une simple manière de « gagner du temps », pour laisser l’enfant faire un choix éclairé face à sa transition. Ce sont des traitements expérimentaux, qui sont prescrits « off label », c’est-à-dire dans un objectif autre que celui pour lequel le médicament a été développé.
La prise de bloqueurs de puberté, mène presque invariablement à la prise d’hormone de l’autre sexe, et comporte de nombreux effets indésirables et bien souvent irréversibles : ostéoporose, stérilité, impossibilité de ressentir du plaisir sexuel. Et pourtant au Québec, le Lupron, un bloqueur de puberté qui crée une « ménopause » artificielle, peut être recommandé par certains pédiatres comme une « option », au même titre que le stérilet ou les anovulants en continu, pour stopper les menstruations d’une adolescente dysphorique dès la première visite de 45 minutes.
Plus généralement, que pensez-vous de la responsabilité de la société à l’égard de l’enfant et de la revendication qui est la sienne ?
La société met en place de nombreuses balises pour protéger les enfants. Il y a un âge minimal pour conduire une voiture, travailler, acheter de l’alcool ou du tabac et fréquenter les bars. Au Québec, par exemple, ce sont encore les parents qui ont l’autorité de décider de l’école secondaire que leur enfant fréquentera (équivalent du collège et du lycée).
Nous pensons que la société doit mettre des balises similaires face aux interventions médicales lourdes et invasives de transition vers l’autre sexe qui, il faut le rappeler, ne sera jamais « complète » au sens biologique et fonctionnel du terme. On peut changer d’apparence, mais on ne peut pas changer de sexe.
Le jugement rendu, en décembre dernier dans l’affaire de Keira Bell stipule qu’un jeune de moins de 16 ans ne peut consentir à un traitement aux bloqueurs de puberté, puisque même les médecins ne sont pas en mesure d’en établir les effets à long terme,. Ce jugement devrait sonner l’alarme chez nos politiciens et leur donner le courage d’agir pour la protection des jeunes.
Nous sommes un groupe entièrement bénévole. Nous voulons ouvrir le débat en le plaçant du côté des parents, de leur mission éducative et de leur responsabilité envers leurs enfants et leur santé à long terme.
Beaucoup de personnes pensent qu’elles ne sont pas concernées et qu’il s’agit d’un phénomène marginal. Il n’en est rien. La transidentification a connu une augmentation fulgurante dans tous les pays occidentaux,, touchant particulièrement les adolescentes. Il existe un besoin criant d’un journalisme d’enquête de qualité : comment se fait-il que le discours dominant soit devenu celui qui enjoint les adultes “d’affirmer” les enfants alors que les études sur les soins dit « affirmatifs » ont été qualifiée de « pauvres » par des organismes indépendants? Quelles sont les transformations sociales, culturelles et institutionnelles qui pourraient expliquer la difficulté à engager une discussion de bonne foi, basée sur des preuves, concernant la meilleure manière de soutenir les enfants à court et à long terme?
« Faites attention à nos enfants, c’est peut-être le vôtre » est le message que nous voulons envoyer à nos cousins français.
Clémence Trilling, Nadia El-Mabrouk membres fondateurs de « pour les droits des enfants du Québec ».